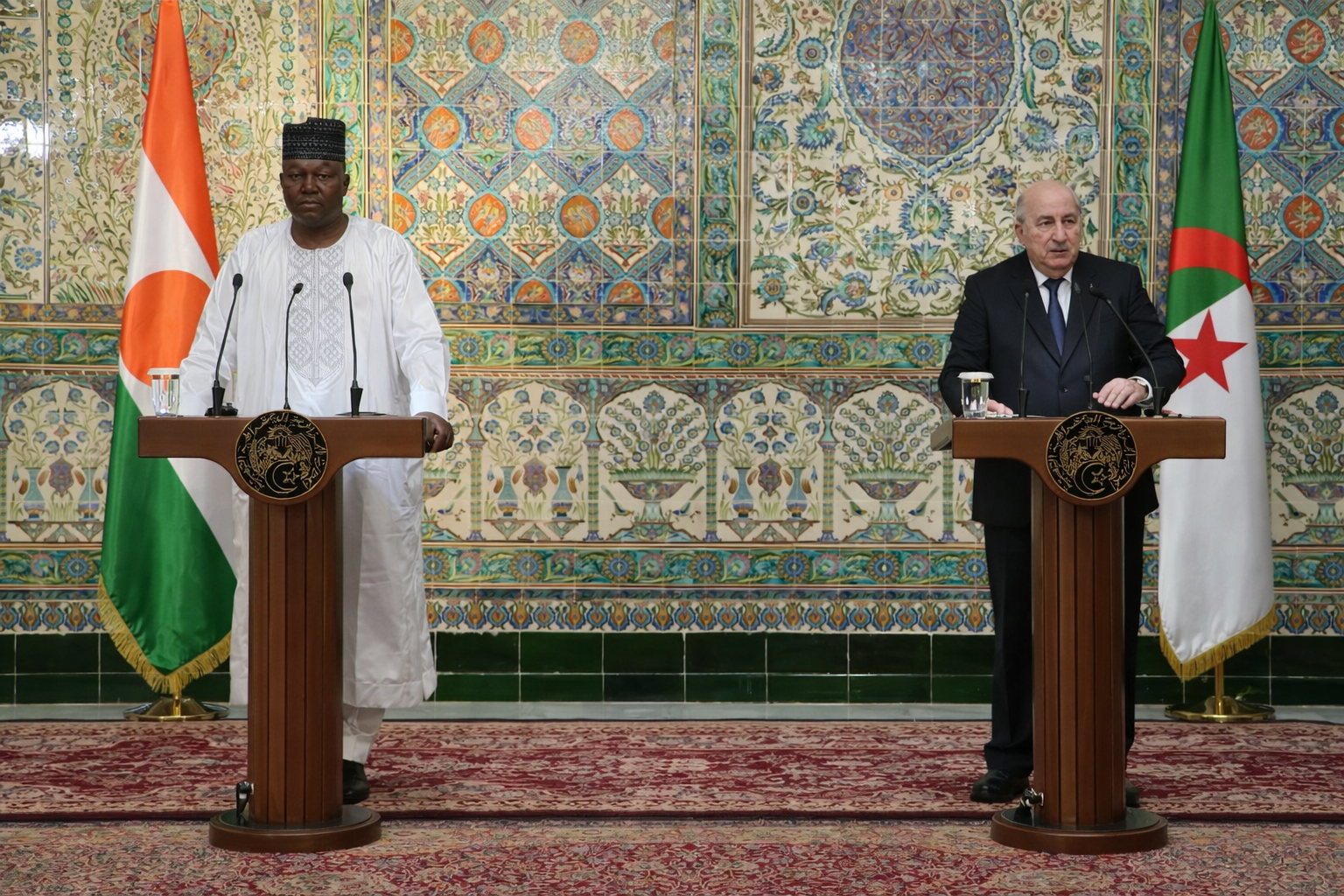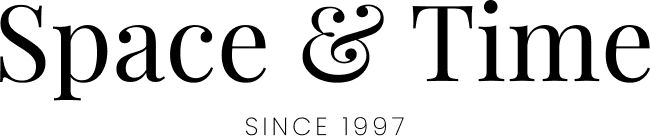Contribution réalisée avec Maître Mahamoud SIDIBÉ, docteur en droit public de l’université Nanterre-Paris-X et avocat à la cour d’appel de Paris.
Jusqu’à présent, l’arrivée au pouvoir de la junte militaire, le 18 août 2020, ne cessait de poser des questions sur l’intention réelle d’Assimi Goïta et de ses hommes ; mais la Charte de la Transition, adoptée par acclamation le 12 septembre 2020, devait finalement conduire le Mali vers la démocratie non seulement parce que le document résultait d’une conférence au cours de laquelle toutes les parties s’étaient exprimées, mais aussi parce que les putschistes s’y étaient engagés après la démission d’Ibrahim Boubacar Keïta. Le M5-RFP et la communauté internationale, les forces politiques, militaires et civiles du pays pouvaient trouver là une garantie vers la restauration rapide et tant attendue d’élections libres et non faussées. Cependant, une analyse attentive du texte révèle des contradictions importantes et de graves atteintes constitutionnelles au point que les doutes concernant le projet des militaires continuent de croître. En effet, la Charte reconnaît la caducité de l’ordre constitutionnel établi et, pour résoudre la crise socio-politique et constitutionnelle, se propose de compléter la Constitution de la Troisième République. Signalons par parenthèse que la coexistence de la Charte et de la Constitution est une solution déjà éprouvée : ce procédé est « une tarte à la crème » juridique qui alimente le débat opposant les tenants du constitutionnalisme classique à ceux du conventionnalisme constitutionnel, remettant en cause la suprématie de la Constitution dans l’ordre juridique interne. En tout cas, sur le plan juridique, les nouvelles mesures qui viennent d’entrer en vigueur soulèvent de nombreuses interrogations. On peut en retenir principalement deux : la Charte malienne de la Transition est-elle un document annexe à la Constitution malienne de 1992 ? Ou bien se substitue-t-elle temporairement à elle ? Nous allons essayer de déterminer la nature juridique réelle de la Charte de la Transition (1). Ensuite, malgré le contenu largement lapidaire du texte, nous montrerons les confusions engendrées par ses dispositions sur les rapports entre les organes de la Transition (2). Les commentaires qui suivent devraient nourrir les discussions sur l’avenir de plus en plus incertain de la démocratie au Mali.
1—La nature juridique incertaine de la Charte de la Transition malienne par rapport à la Constitution de 1992
Si la prise du pouvoir par la junte militaire semble s’inscrire dans un cadre constitutionnel, l’adoption de l’acte fondamental et de la Charte de la Transition révèle la caducité de la Constitution malienne de 1992. Alors, quelle est la nature juridique du texte nouvellement adopté ? Le dernier alinéa de son préambule, en précisant qu’il complète la Constitution, en fait un acte constitutionnel, mais le problème de sa valeur par rapport à la Constitution demeure, car la Charte comporte des dispositions matériellement constitutionnelles, mais primant sur la norme fondamentale. Elle serait donc une « supra-paraconstitution », ou une Constitution juxtaposée à celle de 1992 tout en étant supérieure à elle. Par ailleurs, bien que la Charte de la Transition malienne puisse être rapprochée d’un « pacte extraconstitutionnel » de sortie de crise, elle procède avant tout de la contractualisation, comme l’indique le premier alinéa du préambule, l’énumération des parties révélant que le texte est le produit d’un compromis : « Nous, Forces Vives de la Nation représentées au sein du Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP), du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques du Mali (M5-RFP), des Partis et Regroupements Politiques, des Organisations de la Société Civile de l’intérieur et des Maliens établis à l’extérieur, des Mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger et des Mouvements de l’inclusivité ». Donc, contrairement à un accord politique de sortie de crise, la Charte de Transition est un document élaboré et adopté uniquement par des acteurs internes, sans intervention des instances régionales et internationales. Alors, même si la Charte fait référence au Protocole du 21 décembre 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, elle n’est pas le fruit d’une médiation internationale comme le fut l’accord d’Alger. Elle ne s’inscrit pas dans la même logique que l’accord politique de sortie de crise : elle est un acte constitutionnel visant à conduire et à encadrer la période transitoire avant le retour à la vie constitutionnelle normale et démocratique.
Cette Charte résulte d’un accord socio-politique et militaire. Elle n’est donc pas le produit de la volonté du pouvoir constituant populaire ou l’œuvre d’une Assemblée constituante élue démocratiquement par le peuple. Dès lors, elle ne peut être assimilée à une Constitution adoptée par le peuple, ou ses représentants légitimement élus dans le cadre d’une « délégation du pouvoir constituant fondateur ». Si ce texte se pose comme un instrument juridique, sa dimension constitutionnelle n’en fait pas une « Constitution transitionnelle », car il lui manque surtout l’approbation populaire. La Charte peut toutefois être vue comme une « paraconstitution » complétant la Constitution, mais sa place, alors, est au second plan. Elle peut également apparaître comme une « petite Constitution de crise », étant donné qu’elle rompt temporairement l’ordre constitutionnel ancien. Mais, d’autre part, dans la mesure où elle organise, à titre provisoire, les rapports entre les pouvoirs publics et les institutions, sur la base d’un texte d’apparence consensuel, elle correspond à la définition d’un « ordre constitutionnel transitionnel » formalisé. À cet égard, on peut dire que la Charte est comme une petite Constitution, car elle précise, dans son Titre 2, les principaux pouvoirs publics : le président de la Transition, qui remplit les fonctions de chef de l’État(chapitre 1) ; le gouvernement de Transition (chapitre 2) ; le Conseil national de Transition exerçant les prérogatives du Parlement de la Transition (chapitre 3).
Cependant, si l’article 2, relatif aux missions de la Transition, mentionne « le lancement du chantier des réformes politiques et institutionnelles », aucune disposition n’envisage la création d’une commission qui réfléchirait au rétablissement de la Constitution, à sa révision, ou à l’établissement d’une nouvelle Constitution. Finalement, la Charte est contradictoire à bien des égards, notamment en ce qu’elle entend compléter une Constitution qu’elle estime insuffisante, mais que, étrangement, elle n’indique pas vouloir réécrire. Somme toute, sa coexistence avec l’acte fondamental et la Constitution de la Troisième République annonce des difficultés juridiques et politiques.
2— Les imprécisions et les incohérences du contenu de la Charte
Si l’adoption de la Charte a pour but de contourner les obstacles de la Constitution de 1992, les rapports qu’elle instaure entre les organes de la Transition sont critiquables. On constate ainsi, d’une part, que le texte réalise comme une révision « extraconstitutionnelle » se traduisant par une réécriture de la Constitution de 1992. Trois institutions majeures sont ainsi transformées : la présidence de la République, le gouvernement et l’Assemblée nationale.
Sur la présidence, les modifications sont d’abord formelles et matérielles. Formellement d’abord, les pouvoirs et les prérogatives du président de la Transition sont en principe ceux prévus par la Charte et la Constitution de 1992 dans son Titre III. Mais on se demande alors si la volonté des rédacteurs de la Charte est de limiter les pouvoirs du président de la Transition ou bien de les rendre infinis, en imaginant des prérogatives absentes du Titre III de la Constitution de 1992. Matériellement ensuite, c’est à un collège que reviendra la désignation du président et du vice-président de la Transition, mais sa composition et sa formation ne sont pas mentionnées. De plus, la Charte n’est pas claire sur les pouvoirs partagés des membres de l’exécutif, car l’article 6 prévoit que le vice-président « est chargé des questions de défense, de sécurité et de la refondation de l’État ». Par conséquent, lequel des deux est le véritable titulaire du pouvoir exécutif pendant la période transitoire ? De même, il est regrettable que l’article 6 de la Charte leur donne comme mission « la refondation de l’État »,qui devrait en principe relever du gouvernement, sous la direction du Premier ministre. Finalement, cette charte ne définit pas les rapports entre, d’un côté, les deux têtes de la présidence et, de l’autre, le gouvernement et le Conseil national de Transition. Il aurait pourtant suffit de renvoyer à la Constitution de 1992 concernant les rapports entre les pouvoirs constitutionnels.
Les conditions pour être président ou vice-président de la Transition sont clairement posées par l’article 8 de la Charte : « Tout candidat aux fonctions de Président et de Vice-Président de Transition doit remplir les conditions suivantes : être une personnalité civile ou militaire ; être de nationalité malienne d’origine ; être âgé de 35 ans au moinset de 70 ans au plus ; être intègre, de bonne moralité et impartial ; être une personnalité de notoriété publique ; jouir de ses capacités physique et mentale ; n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ; être reconnu pour son engagement dans la défense des intérêts nationaux ». Il en ressort que le président de la Transition peut être un civil ou un militaire. De même, l’article 8 ne prévoit pas qu’un président militaire soit assisté d’un vice-président civil. Ce choix est tout à fait malheureux, car la seconde figure de l’exécutif, en étant choisie au sein de l’armée, sera certes compétente sur les questions sécuritaires, mais les sujets politiques risqueront fort de lui être étrangers.
De plus, l’article 4 de la Charte précise que « le Président de Transition est choisi par un collège de désignation mis en place par le Comité National pour le Salut du Peuple ». Cette disposition est toutefois contestable, car le futur président de la Transition pourrait apparaître comme un chef sous contrôle de la junte militaire, d’autant que la composition et la formation de ce collège ne sont nullement écrites dans le texte. L’article 9, quant à lui, précise que « le Président et le Vice-Président de la Transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition ». Cette mesure paraît bonne, car elle devrait assurer la continuité de l’État et la stabilité politique du Mali après la Transition. Enfin, la vacance de la présidence et l’empêchement du chef de l’État sont réglementées par l’article 11 de la Charte.
Au sujet du gouvernement, les dispositions sont floues quant à la personnalité civile du Premier ministre de la Transition. Si la limitation du nombre des membres du gouvernement à vingt-cinq (25) est heureuse, sa composition sera critiquable dans la mesure où certains acteurs du régime précédent peuvent participer légitimement à sa formation.
Précisons que les conditions pour être Premier ministre et membre du gouvernement sont clairement posées à l’article 13 de la Charte qui prévoit également que « les membres du gouvernement de Transition ne sont pas éligibles aux élections présidentielle et législatives qui seront organisées pour marquer la fin de la transition ». La Charte n’est pas aussi claire sur la personnalité du Premier ministre. Or, celui-ci devrait être un homme de dossiers, compétent pour conduire la destinée de la Nation dans une période de crise.
Concernant le Conseil national de Transition, il est présenté comme « l’organe législatif de la Transition » et sera composé de cent vingt et un (121) « membres répartis entre les Forces de Défense et de Sécurité, les représentants du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques du Mali (M5-RFP), les Partis et Regroupements politiques, les Organisations de la société civile, les centrales syndicales, les syndicats libres et autonomes, les organisations de défense des Droits de l’Homme, les Ordres professionnels, les Maliens établis à l’extérieur, les Mouvements signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger, les Mouvements de l’inclusivité, les groupements de femmes et de jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les confessions religieuses, les autorités traditionnelles, les chambres consulaires, les faîtières de la presse, des Arts de la Culture ». Or, si le Conseil national de Transition apparaît comme un Parlement de transition aux termes de la Charte, sa composition ne se fera pas sans mal, car il sera difficile de trouver un consensus socio-politique sur la répartition de ses 121 membres entre les forces politiques, civiles et militaires. Soulignons à leur propos que rien n’est indiqué quant à leur qualité, alors qu’ils ne peuvent être députés, d’après les articles 60, 61 et 62 de la Constitution 1992, que s’ils « sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct ».
La Charte, en son article 18, prévoit sa possible révision : «L’initiative de la révision de la présente Charte appartient concurremment au Président de Transition et au tiers (1/3) des membres du Conseil national de Transition. Le projet, ou la proposition de révision, est adopté à la majorité des 4/5es des membres du Conseil National de Transition. Le Président de Transition procède à la promulgation de l’acte de révision ». On trouve ici une application partielle de l’article 118 de la Constitution de 1992 relatif à la révision constitutionnelle. De plus, l’article 19 limite la durée la Transition à « dix-huit (18) mois à compter de la date d’investiture du Président de la Transition ». Pourtant, il est regrettable qu’aucune clause, en cas d’impossibilité d’organiser les élections générales, ne prolonge de six mois la durée de la Transition.
Par ailleurs, si le CNSP considère que le Président Ibrahim Boubacar Keïta a démissionné, donc qu’il n’a pas été chassé par un coup d’État, il est absurde de prévoir « l’immunité juridictionnelle » des « membres du Comité National pour le Salut du Peuple et [de] tous les acteurs ayant participé aux événements du 18 août 2020 à l’investiture du Président de Transition ». L’adoption d’« une loi d’amnistie », aux termes de l’article 20 de la Charte de la Transition, n’est rien de moins qu’incohérente. Enfin, si ce document ne peut avoir la prétention de tout prévoir ou tout résoudre, il est regrettable qu’il puisse primer sur la Constitution de 1992 « en cas de contrariété » dans leur rapport. Autrement dit, l’article 22 de la Charte relègue la Constitution au second plan pendant la période transitoire si un conflit d’interprétation ou d’application se présente entre les deux textes.
L’existence de la Charte se justifie certes par le besoin de régler une crise socio-politique et institutionnelle, mais sa primauté sur la norme fondamentale est inacceptable, sous le prisme de la conception kelsénienne de la Constitution. Si la démission militairement assistée du Président IBK semble avoir ouvert la transition, celle-ci demeure inquiétante parce que le processus transitionnel, qui, par définition, est temporaire, semble devoir durer, et parce que la Charte, en définitive, finit de déstabiliser un ordre juridique que les dirigeants précédents avaient gravement ébranlé.
La politique malienne au garde-à-vous
Le 23 septembre 2020, la junte qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) voilà un peu plus d’un mois a rendu public le nom du président de la Transition. Le choix s’est porté sur le colonel Bah N’Daw, retraité de l’armée malienne. Une fois de plus, donc, un officier devient chef de l’État. À compter du vendredi 25 septembre, date de son entrée en fonction, il est secondé par un vice-président, le dirigeant du Comité national pour le Salut du Peuple (CNSP) et lui aussi colonel, Assimi Goïta. C’est là un énième témoignage de l’emprise de l’armée dans la gestion de l’État, car, depuis l’indépendance en 1960, les militaires sont au pouvoir. Pour des raisons multiples, ils ont occupé un rôle permanent dans le gouvernement du pays, même quand des civils en conduisaient la destinée. La politisation excessive de l’armée a cependant fini par produire des effets délétères sur la démocratie et les institutions. Toutefois, certains persistent à voir en elle le seul rempart à la mauvaise gouvernance, même s’il faut pour cela renoncer à la démocratie. L’alternative qui se présente ainsi pose alors un problème de philosophie politique que les élites maliennes sont impuissantes à régler.
Le Mali inaugure le régime des colonels. En effet, alors qu’Assimi Goïta promettait de rendre le pouvoir aux civils au lendemain de la chute d’IBK, il est désormais vice-président et assiste le colonel Bah N’Daw, le nouveau président. Ce dernier intègre donc la liste des chefs militaires qui ont dirigé le pays presque continuellement depuis soixante ans : Moussa Traoré, Amadou Toumani Touré, Amadou Haya Sanogo et Assimi Goïta. Quatre civils seulement, Modibo Keïta, Alpha Oumar Konaré, Dioncounda Traoré et Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), ont eu le privilège de diriger le Mali entre quatre coups d’État fomentés par l’armée. Cette omniprésence en politique depuis 1960 vient de ce que les militaires se sont toujours posé en recours aux dirigeants qui ne pouvaient achever leur mandat sans être fortement contestés par les citoyens ; ceux-ci dénonçant les problèmes de gouvernance, l’incapacité du personnel politique, réclamant aussi de participer davantage aux élections, et se plaignant de la gestion inefficace de la crise sécuritaire (citons ainsi les actes terroristes et la rébellion dans le nord du pays). Par conséquent, aux yeux de certains, les militaires sont les seuls à garantir un minimum d’espoir en un avenir meilleur.
Alors, conscients, peut-être, de leur responsabilité, les militaires s’intéressent beaucoup à la politique, tellement même qu’ils s’autorisent à prendre le pouvoir, parfois à le rendre aux civils, souvent à le garder pour eux : l’actualité en est un exemple flagrant. La charte de la Transition, de laquelle le M5-RFP attendait tant, a finalement suscité de grandes déceptions, car non seulement les civils sont écartés de la présidence du Mali, mais l’armée s’est aussi réservé les postes clefs. Les effets de cette politisation excessive ne peuvent donc que nuire à la fois à la démocratie et aux institutions. Il serait long de dresser la liste complète des atteintes graves portées à l’État de droit quand l’armée dirige, ces dernières semaines notamment : le départ d’IBK s’est fait sans le consentement du peuple ; la dissolution de l’Assemblée nationale a empêché son président d’assurer l’intérim des fonctions de chef de l’État ; la charte de Transition du CNSP, imposée aux Maliens, est juridiquement absurde et inique, car elle « complète » la Constitution tout en lui étant supérieure (sic !), d’après l’article 22… Rien, semble-t-il, ne peut conduire à soutenir de tels agissements.
Cependant, certains sont prêts à des compromis de taille qui peuvent tenir lieu de compromissions : ceux-là défendent un « régime militaire civilisé » qui, certes, appauvrirait les acquis démocratiques, mais permettrait un assainissement de la vie publique et la fin de pratiques illégales tel le clientélisme dans les recrutements de la fonction publique. En fin de compte, le Mali est-il condamné à se passer de la démocratie pour profiter d’une bonne gestion du pays ? À l’évidence, cette alternative, telle que la pose finalement les militaires aujourd’hui en place, révèle bien plus qu’une crise de la représentation politique, incapable de répondre aux besoins et aux attentes d’un Mali nouveau : elle illustre la vacuité de la pensée politique en Afrique noire francophone.
Dr. BALLA CISSE
Avocat au Barreau de Paris